Païta, un Chagall musical

26 septembre 2025
Antonin Dvorak : Symphonies n° 7, 8 et 9 – Leos Janacek : Taras Boulba ; Orchestre philharmonique, Royal Philharmonic Orchestra, Carlos Païta ; # Le Palais des Dégustateurs PDD 045 ; Enregistrements 1980, 1982, 1989, Sortie le 26 septembre 2025 (70:18 + 66:03) – Critique de Remy Franck
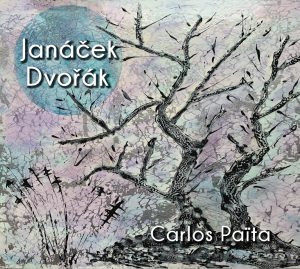
Ce double album s’ouvre sur une interprétation phénoménale de la Symphonie n° 7 d’Antonin Dvorak. Énergie et intensité sont au rendez-vous, mais surtout, il se nourrit des sautes d’humeur, allant de l’enthousiasme fougueux à l’anxiété profonde. Païta sublime particulièrement les passages sombres du premier mouvement, apportant un éclairage nouveau sur cette musique.
Dans la Septième, comme dans ses autres œuvres, Païta démontre que les symphonies de Dvorak sont bien plus que de brillantes pièces orchestrales qui se contentent d’évoquer des images sans rien de plus profond à dire. Ici, les profondeurs sont pleinement explorées ! Le Dvorak de Païta est une musique d’une intensité frénétique, pleine de tension et d’émotion intérieure, une musique empreinte de sensibilité et de passion.
La Septième Symphonie est exemplaire à cet égard : le chef parvient à créer un large arc musical à travers les quatre mouvements. Il dirige l’orchestre enchanteur avec verve et brio tout au long de l’œuvre, dont l’importance et la grandeur ne sont véritablement saisies que par cette interprétation.
Dans la Huitième Symphonie de Dvorak, l’Argentin réussit un mélange très équilibré d’interprétation dramatique, de moments folkloriques et de brillance orchestrale. Une fois de plus, l’intensité de la musique et, surtout, les couleurs, qui révèlent en Païta un Chagall musical, sont impressionnantes. Les bois du Royal Philharmonic brillent sous les mains évocatrices de Païta.
Et si l’auditeur n’est jamais plongé dans une musique arbitraire, mais demeure constamment en suspens, ici aussi, outre les bouquets de couleurs, les moments de nostalgie et de mélancolie sont particulièrement saisissants, comme dans le mouvement lent, caractérisé par un contraste captivant entre lumière et obscurité.
Le finale, dansant et coloré, couronne cette interprétation, l’une des meilleures que je connaisse. Païta choisit des tempi plutôt modérés, évitant ainsi l’effet toujours enflammant du « rapide et fort », mais convainc par ses changements d’humeur, ses moments de mélancolie merveilleusement savourés et ses touches de couleur. Païta dément sans conteste tous ceux qui considèrent cette symphonie comme totalement insouciante.
Avec un contraste saisissant entre l’introduction très lente et l’Allegro molto, Païta entame une Neuvième tout aussi remarquable. Ce mouvement est plus riche que ce que d’autres chefs ont pu réaliser. La musique n’est pas superficiellement brillante, mais dramatiquement turbulente.
Une tranquillité singulière et une atmosphère absolument merveilleuse caractérisent le mouvement lent. Avec près de 16 minutes, Païta dépasse largement la moyenne de 12 minutes et se situe à mi-chemin entre le premier enregistrement de Bernstein (14:43) et son enregistrement viennois (18:22).
Le Scherzo suit avec d’autant plus de vivacité et d’énergie, avec un trio finement nuancé et un bref grondement sombre peu avant la fin. L’Allegro con fuoco s’épanouit dans la dynamique et la couleur sans être précipité. Païta prend le temps de dépeindre avec force tous les personnages, donnant à la pièce une vie bien plus qu’une simple énergie cinétique.
L’interprétation de la Rhapsodie de Taras Boulba en trois mouvements, inspirée de la nouvelle de Gogol par Leos Janacek, est tout aussi captivante et électrisante. Taras Boulba de Païta est si tendue et captivante qu’elle éclipse toutes les autres interprétations possibles, y compris celle de Simon Rattle. Nous entendons des représentations musicales du destin spirituellement et émotionnellement profondes, qu’on ne pourrait imaginer plus puissantes.
