Anatoli Liadov ou l’art de la miniature à la russe.
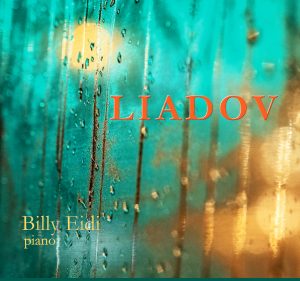

Lorsqu’on évoque le nom de Billy Eidi, on a l’image d’un pianiste raffiné et un grand spécialiste de la musique française au tournant du vingtième siècle. D’origine libanaise, Billy Eidi formé à Beyrouth puis à Paris ne se contente pas d’interpréter les œuvres marquantes de ces compositeurs célèbres comme Ravel ou Debussy car il est un interprète particulièrement curieux et recherchant des répertoires peu fréquentés. Avec ses enregistrements, il nous révèle de véritables pépites musicales, comme cette intégrale des cinquante-trois pièces du « Rossignol Eperdu » de Reynaldo Hahn ou encore ces mélodies de Maurice Delage, compositeur aujourd’hui bien délaissé et à qui son ami Maurice Ravel lui dédia « La vallée des cloches » terminant son recueil des Miroirs. La discographie de Billy Eidi est particulièrement éloquente et révélatrice de ses goûts musicaux, où l’on retrouve Erik Satie, Gabriel Fauré, Déodat de Séverac, Arthur Honegger, Henri Sauguet, Albert Roussel, Guy Sacre, et même la Symphonie pour la Pologne de Saint-Preux. A l’exception d’un enregistrement consacré aux œuvres pour piano d’Alexandre Scriabin, sa discographie était jusqu’à présent centrée sur la musique française. Son nouvel enregistrement présente un choix significatif d’œuvres pour piano d’Anatoli Liadov qui, convenons-en, n’est pas le compositeur le plus médiatique du répertoire russe. Fort injustement négligé, la musique de Liadov est généralement absente des concerts et n’est que très rarement abordée au disque, si ce n’est que comme « complément de programme ». Ce relatif oubli est sans doute dû à un problème de génération car Anatoly Liadov, comme Anton Arensky, Sergei Taneïev et Alexandre Glazounov, tous nés entre 1855 et 1865, sont à la fois des compositeurs, pianistes et pédagogues, et tous les quatre ont vécu dans une époque charnière où ils ont été pris en étau entre deux périodes particulièrement marquantes de la musique russe. Descendant d’une famille de musiciens, Liadov a été fortement influencé par les compositeurs de la génération précédant la sienne qui, juste après Glinka, ont été les pionniers de la musique russe dans la mouvance romantique, avec notamment le « Groupe des Cinq » (formé par Mily Balakirev, Alexandre Borodine, César Cui, Modeste Moussorgsky et Nikolaï Rimski-Korsakov), et bien entendu Piotr Illich Tchaïkovsky qui n’avait pas souhaité s’associer au Groupe des Cinq. Anatoly Liadov, formé par Rimski-Korsakov (le plus jeune des compositeurs du Groupe des Cinq) fera d’ailleurs momentanément partie de cette prestigieuse confrérie, avant d’intégrer un autre groupe créé par le musicographe Victor Belaïev. Rappelons qu’en dehors de Balakirev qui a été le fondateur et le guide quelque peu despotique du Groupe des cinq, les autres musiciens avaient tous à l’origine un métier à côté de leur activité musicale (Moussorgsky était militaire, Borodine était chimiste, Cui était critique musical et Rimski-Korsakov était marin). Les musiques composées par ces musiciens « amateurs » de par leur profession, mais totalement innovants dans leur langage ont permis l’émergence d’une musique typiquement russe. Leurs opéras sont solidement ancrés dans le folklore et dans l’histoire de la Russie (Boris Godounov, la Khovantchina, le Prince Igor etc…), mais aussi dans les légendes ancestrales (comme la Cité invisible de Kitège). Ces œuvres véhiculent l’âme de la Russie et de son peuple, et s’appuient souvent sur la riche et abondante littérature russe (Ostrovsky pour Snegourotchka de Rimski-Korsakov, Gogol pour La foire de Sorotchinsky de Moussorgsky, Pouchkine pour Eugène Onéguine et pour la Dame de Pique de Tchaïkovsky etc..).
Cette première génération de compositeurs russes a servi de modèle à cette génération à laquelle appartient Liadov, qui a pris naissance dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Compte tenu de l’abondance et de la qualité des œuvres laissées par leurs prédécesseurs (musique symphonique, musique concertante, opéras, musique de chambre, musique instrumentale, mélodies etc..), Liadov et ses collègues ont été quelque peu complexés malgré leur désir ardent de composer et de contribuer à leur tour au développement de la musique russe. Leurs œuvres seront cependant moins marquantes et ils s’orienteront naturellement vers la préservation et la transmission de ce riche patrimoine musical. Leur enseignement sera déterminant pour la génération suivante, née au début du vingtième siècle. Anatoly Liadov était encore enfant lorsque les deux principaux Conservatoires de Russie ont été créés : 1862 pour Saint-Pétersbourg et 1866 pour Moscou. Liadov intégrera le Conservatoire de Saint-Pétersbourg en 1870 où il recevra l’enseignement de Rimski-Korsakov. Lorsqu’il en sort malgré un parcours quelque peu chaotique causé par un absentéisme chronique, il possède un solide bagage de pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Liadov élargira encore le champ de ses activités en réintégrant le Conservatoire de Saint-Pétersbourg à partir de 1876, mais cette fois-ci en qualité de professeur d’harmonie et de composition.
Liadov enseignera la musique à une nouvelle génération de remarquables musiciens russes dont Prokofiev, Miaskovsky et Gnessine, pendant qu’Arenski (qui a suivi un parcours similaire à Moscou), enseignera à Scriabine, et Rimski-Korsakov à Stravinsky. Liadov, comme Arensky et Taneïev malgré leur grand talent seront finalement victimes de leur époque, occultés d’un côté par leurs illustres devanciers, et éclipsés de l’autre par cette jeune génération réformatrice qui émergera au début du vingtième siècle en faisant évoluer de façon radicale le langage musical russe, tout en préservant son ADN.
Le sort a été particulièrement ironique avec Liadov et ses collègues si l’on considère que la grande majorité de ces jeunes musiciens constituant la nouvelle génération ont été leurs élèves. Cela explique le relatif oubli des œuvres de Liadov, qui n’a rien à voir avec la qualité de ses œuvres. Si Anatoli Liadov était un compositeur extrêmement doué et inventif, il était cependant frappé par un défaut qui aura beaucoup de répercussions sur sa carrière : Il manquait de confiance en lui et avait la réputation d’être atteint d’une certaine paresse. Une anecdote est très révélatrice de cette indolence créatrice : A l’origine, Serge Diaghilev le directeur des Ballets Russes avait demandé à Liadov de composer la musique de l’Oiseau de feu. Au bout d’une longue période, Diaghilev n’ayant pas de nouvelles de Liadov finit par le relancer. Liadov lui répondit finalement : « ça avance très bien, j’ai déjà acheté le papier à musique !». Il n’est pas surprenant qu’à la réception de cette réponse, certes humoristique, Diaghilev ait confié la composition de l’Oiseau de feu à l’entreprenant et génial Igor Stravinsky. Si Liadov est profondément ancré dans cette âme russe faite à la fois de fatalisme de violence et de tendresse, sa musique pour piano subira aussi des influences extérieures comme celles de et notamment de Schumann et surtout de Chopin, deux experts de la forme brève. Les œuvres courtes deviendront la marque de fabrique de Liadov dont l’intégralité des pièces pour piano (à l’exception de deux cycles de variations) n’excèdent pas les sept minutes, l’Idylle opus 25 étant la plus longue comme le révèle ici l’enregistrement de Billy Eidi. La musique pour piano de Liadov constitue une part importante de sa production puisque sur les soixante-sept numéros d’opus de son catalogue, quarante-trois correspondent à des œuvres pour piano.
Comme beaucoup de compositeurs russes de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, Liadov était particulièrement influencé par Chopin. Liadov reprend largement la terminologie chopinienne pour intituler ses œuvres (Préludes, Mazurkas, Etudes, Barcarolle, Berceuse, Valse etc…) ; on retrouvera d’ailleurs des titres similaires chez Scriabine et chez Rachmaninov.
Cet enregistrement de Billy Eidi, outre le fait de faire découvrir des musiques oubliées nous permet de pénétrer dans un univers musical qui a aujourd’hui totalement disparu, celui des salons de l’intelligentsia russe à l’époque des derniers tsars, où la musique de Liadov était fréquemment jouée. Ce monde artistique russe à la fois si rare et fragile était particulièrement raffiné. La musique, la poésie et la littérature se côtoyaient harmonieusement dans les salons des aristocrates pétersbourgeois et moscovites, et faisaient écho aux salons organisés dans les grands centres culturels d’Europe occidentale au début du dix-neuvième siècle comme Vienne, Londres et Paris. Les artistes baignaient alors dans cet univers culturel aussi cosmopolite qu’intense où ils se retrouvaient très régulièrement pour discuter librement d’art, de politique ou de philosophie, mais aussi pour présenter leurs dernières compositions.
Liadov a composé plus de cent vingt courtes pièces pour piano dont Billy Eidi nous offre panorama très représentatif. Celles-ci, aussi poétiques qu’intimes, révèlent sa personnalité et montrent aussi ce qui différencie ce musicien des autres compositeurs russes. Liadov se montre un des maîtres de la forme brève et si l’influence de Chopin l’emporte majoritairement dans ses œuvres, Robert Schumann était aussi un modèle de sa jeunesse comme en témoignent ses premières compositions à l’écriture fiévreuse, fourmillant d’idées fugaces et exprimées dans des atmosphères changeantes. Dans cet enregistrement Billy Eidi privilégie cependant l’influence de Chopin bien que contrairement à ce dernier, Liadov n’ait jamais composé des pièces de grande envergure comme les trois sonates (en quatre mouvements), ou même des pièces en un unique mouvement, mais très développées comme la Fantaisie en Fa mineur, les Grandes Polonaises, les Scherzos ou les Ballades.
Si les influences de Chopin sont fréquentes dans les œuvres pour piano de Liadov, elles n’en sont pas pour autant de pâles copies, ni des hommages déguisés. Il serait inopportun de comparer les deux compositeurs qui ne vivaient ni à la même époque (Liadov est né cinq ans après la mort de Chopin) ni dans le même univers culturel. La poésie qui émane des œuvres de Liadov est très puissante et évocatrice de cette culture russe subtile et empreinte d’une sensibilité qui lui est propre.
La production pianistique de Liadov comporte d’une trentaine de Préludes épars dont Billy Eidi nous en présente neuf parmi les plus significatifs, qu’ils soient rattachés au même cahier comme les « Trois préludes opus 36 » ou faisant partie d’un recueil de pièces diverses comme les « trois morceaux opus 57 » constitués d’un prélude, d’une valse et d’une Mazurka. Contrairement à ceux de Chopin, les Préludes de Liadov n’étaient pas destinés à faire partie d’un projet musical plus vaste, utilisant un ordonnancement par tonalités. Il faudra attendre Rachmaninov et Scriabine pour voir après Bach et Chopin de telles constructions. Billy Eidi nous propose sept Mazurkas composées par Liadov qui en écrira treize. Comme le fait remarquer très opportunément Guy Sacre dans l’excellente pochette de présentation du disque : « Liadov, dans ses Mazurkas se montre d’ailleurs plus slave que Chopin, d’un « Slavisme » plus primitif et plus innocent ». Comme on le sait, Chopin ne se basait pas sur des mélodies issues du folklore polonais pour écrire ses Mazurkas, mais il composait ses propres mélodies qu’il harmonisait ensuite à sa façon. Les Mazurkas de Chopin sont des œuvres « idéalisées » et créées de toutes pièces. Si Liadov, malgré la finesse de son écriture pianistique, n’atteint peut-être pas ce suprême raffinement, il se rapproche plus que Chopin de l’Esprit de la Mazurka originelle par sa simplicité et sa rusticité. Liadov fait d’ailleurs évoluer progressivement son style vers un discours plus déclamatoire et fiévreux trahissant ses origines slaves comme dans cette admirable Mazurka Opus 38, la plus développée de son répertoire. Par leur style, les autres pièces figurant sur cet enregistrement ne manquent pas de références aux œuvres de Chopin :
La volubile Etude opus 37 où mains droite et gauche s’affrontent rythmiquement tout en faisant ressortir certaines notes inclues dans le flot continuel de double-croches de la main droite. Au-delà de toute considération didactique, Liadov compose une œuvre fluide et gracieuse. La Barcarolle Opus 44 est peut-être le chef-d’œuvre pianistique de Liadov, même si le modèle chopinien n’est jamais très éloigné, jusqu’à en emprunter la tonalité. Cependant, cette œuvre conserve toute son originalité avec sa ligne mélodique d’une grande tendresse. La Berceuse Opus 24 s’inspire directement de celle du Maître polonais, que ce soit par une certaine similitude thématique et par sa construction en forme variée. On retrouve dans les deux pièces le même esprit délicat et tendre. Enfin, la pièce la plus vaste du répertoire pianistique de Liadov est l’Idylle opus 25. Si ce titre ne fait aucunement référence à Chopin, Liadov en conserve les tournures et la Musique pour piano de Guy Sacre, ce dernier défend ardemment cette œuvre : « Que l’on continue de négliger les préludes, si fragiles, si rares où la pensée va si vite au but qu’elle déconcerte les distraits, cela se conçoit à la rigueur. Mais que cette ample composition, dont les splendeurs anticipent sur celles de la Barcarolle de 1898, n’ait pas connu un meilleur sort, voila qui sidère ! Il faut redécouvrir cette page, assurément moins russe qu’italienne et où, au souvenir du Chopin des derniers Nocturnes, se même celui du Liszt des Années de pèlerinage ». La poésie qui émane de l’interprétation de Billy Eidi ne fait que confirmer les propos fort pertinents de Guy Sacre.
La discographie de Liadov est loin de rendre hommage au talent de ce compositeur à redécouvrir impérativement et dont le répertoire ne se limite pas au piano. Si son œuvre de musique de chambre est très réduite, il a par contre laissé sur la fin de sa vie plusieurs œuvres orchestrales non négligeables. Les intégrales de son œuvre pour piano ne sont pas nombreuses (Marco Rapetti et Olga Solovieva), une anthologie par Inna Poroschina, quelques rares CD intégralement consacrés à Liadov par Stephan Coombs et Megumi Sano, et enfin quelques maigres sélections par de grands pianistes russes : Tatiana Nikolayeva, Vladimir Sofronitzky, Boris Berezovsky, Vladimir Ashkenazy et Sviatoslav Richter et enfin un enregistrement Arensky/Liadov de la pianiste Swetlana Meermann-Muret reprenant quatorze pièces de Liadov. C’est dire si le présent enregistrement de Billy Eidi est bienvenu et précieux, d’autant qu’il a été réalisé dans un confort sonore appréciable, ce que ne pouvaient offrir les versions historiques citées précédemment.
Billy Eidi donne à ces œuvres une interprétation particulièrement inspirée en respectant le style du compositeur, raffiné et fluide comme du Chopin et en même temps avec une personnalité propre à ce compositeur qui assume son identité russe dans ces pièces brèves mais qui demeurent extrêmement denses et poétiques.
Notes : Son : 8,5 – Livret : 9 – Répertoire : 9 – Interprétation : 9
Jean-Noël Régnier
Lien vers l’article original : https://www.crescendo-magazine.be/anatoli-liadov-ou-lart-de-la-miniature-a-la-russe/
