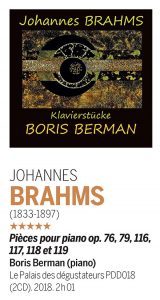 Qu’ils sont difficiles, ces opus que Boris Berman joue sur un Steinway qui sonne avec un naturel troublant, capté par des micros judicieusement placés en regard de l’écriture même de pièces qui n’exigent pas le vaste espace acoustique d’une grande salle de concert, mais ne se satisferaient pas davantage de la matité d’un salon étouffé.
Qu’ils sont difficiles, ces opus que Boris Berman joue sur un Steinway qui sonne avec un naturel troublant, capté par des micros judicieusement placés en regard de l’écriture même de pièces qui n’exigent pas le vaste espace acoustique d’une grande salle de concert, mais ne se satisferaient pas davantage de la matité d’un salon étouffé.
Si Brahms a parlé de « berceuses de ma douleur » en évoquant ses pièces tardives, faut-il les jouer comme si le piano était sur un catafalque ? Non ! Et Boris Berman l’a bien compris : il a choisi une salle pas trop grande, ne force aucun fortissimo, n’explore pas davantage l’infiniment petit du pianissimo, invente mille nuances dans une dynamique réduite. Son jeu est détendu, comme allant de soi : il semble en fait qu’il joue pour vous seul, pour vous montrer la beauté de cette musique si complexe – et le cachant si bien. Sa maîtrise du cantabile éloquent, sa capacité à modeler le son en continu, son jeu de pédales qui soutient sans jamais les mélanger les lignes sinueuses et enchevêtrées du compositeur, font qu’il organise secrètement un discours fluide qui attrape l’oreille de l’auditeur sans jamais le prendre par le sentiment. Il y a bien sûr des manières autres, plus caractérisées et variées, comme, par exemple, Wilhelm Kempff dans les années 1950 (Decca et Deutsche Grammophon). Mais Berman avance comme le soleil, trouant les nuages dans un ciel, éclaire la campagne de couleurs automnales laissant derrière leur passage le paysage intact. Et c’est beau !
Alain Lompech
